Au Québec, plusieurs lois et règlementations régulent le secteur de la construction. La Régie du bâtiment du Québec (RBQ) a un rôle crucial à y jouer, puisqu’elle atteste la qualité des bâtiments, en assurant notamment la qualification des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires. Cela signifie que toute personne désirant effectuer des travaux pour autrui doit être titulaire d’une licence délivrée par la RBQ.
Qu’est-ce qu’une licence RBQ et qui doit se la procurer ?
La licence RBQ est une autorisation à procéder à des travaux de construction ou de rénovation. Elle atteste également que l'entreprise titulaire de la licence est qualifiée et qu’elle respecte les normes établies. Que vous soyez un entrepreneur en construction, un promoteur ou un propriétaire désirant effectuer des travaux de construction vous-même, vous avez l’obligation de vous procurer une licence RBQ.
La notion de propriétaire comporte cependant quelques exemptions. Si vous effectuez des travaux sur votre propre maison unifamiliale ou d'autres ouvrages réservés à l'usage de votre famille, vous n'avez pas à vous procurer de licence. Le règlement intervient uniquement pour les propriétaires de bâtiments publics ou à revenu. Nous vous conseillons tout de même de vérifier vos obligations auprès de la RBQ avant le début de votre projet.
Comment obtenir une licence RBQ?
Pour se procurer une licence RBQ, vous devez d’abord en faire la demande. Pour ce faire, il faut rensigner la forme juridique de l'entreprise (personne physique, personne morale ou société), son numéro d’entreprise du Québec, un cautionnement ou plan de garantie, la catégorie de licence souhaitée, ainsi que la ou les sous-catégories.

Pour que la demande soit approuvée, des examens sont exigés afin de vérifier les compétences du demandeur : le nombre et la nature de ces examens dépendent du type de licence demandé. Dans le cas de personnes morales ou de sociétés, seuls les dirigeants doivent faire les examens, puisqu'ils agissent comme répondants. En général, les acquis de ces examens sont valides pour une durée de 5 ans après la date de fin de la licence, à la suite de laquelle il faut repasser les examens pour recevoir une nouvelle licence.
Notez qu’il est toutefois possible d’être exempté de passer les examens grâce aux équivalences. Par exemple, les programmes de formations reconnues par la RBQ peuvent être considérés comme équivalents à certains examens. D'ailleurs, nous offrons, chez Écohabitation, plusieurs formations pour professionnels reconnues par la RBQ, vous permettant de vous renseigner sur l'habitation durable tout en cumulant des heures de formation continue.
Une autre option est de transmettre un dossier professionnel démontrant votre qualification. Cette méthode s'applique uniquement si vous travaillez déjà dans le domaine ou si vous avez suivi d’autres types de formations. Ce dossier doit contenir plusieurs documents et lettres spécifiques : il faut donc vous assurer de bien suivre les instructions afin que le processus de vérification se déroule pour le mieux. Attention, toutefois, seules les expériences et les acquis scolaires des milieux suivants peuvent être reconnus : administration, gestion de la sécurité sur les chantiers, gestion de projets et de chantiers, et exécution de travaux de construction.
Quels travaux nécessitent une licence RBQ ?
La plupart des travaux de construction nécessitent une licence RBQ. En fait, elle est obligatoire pour modifier, ajouter ou démolir l’un des éléments de la liste ci-dessous :
- Bâtiment et son équipement
- Équipement destiné à l’usage public
- Installation non rattachée à un bâtiment
- Installation d’équipement pétrolier
- Ouvrage de génie civil
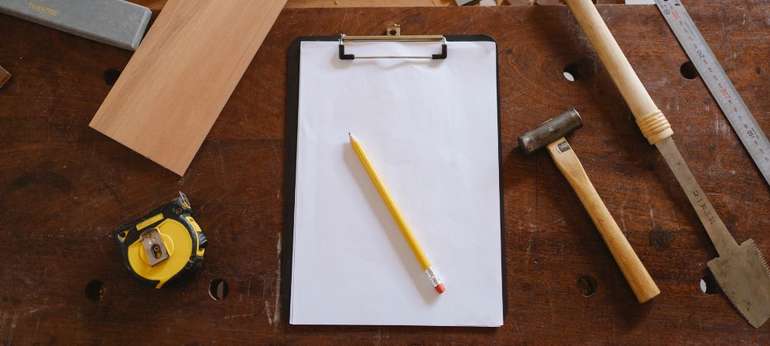
Les exemptions au permis RBQ
Certains entrepreneurs ou constructeurs-propriétaires sont exemptés de l’obligation de se procurer une licence RBQ lorsqu’il s’agit de sociétés d’entrepreneurs, d’exploitation agricole, d’équipement pétrolier ou de syndic de faillite/d’un liquidateur. Informez-vous pour vérifier si votre situation se rattache à l’une de ces exceptions.
Les autres licences pour les travaux spécifiques
Quelques catégories de travaux ne nécessitent pas de licence RBQ, mais plutôt un autre type de licence. Pour les travaux d’électricité, par exemple, la licence est délivrée par la Corporation des maîtres électriciens du Québec (CMEQ). Pour ce qui est des travaux spécialisés en plomberie, en chauffage, en brûleurs à huile ou au gaz naturel, c’est auprès la Corporation des maîtres mécaniciens en tuyauterie du Québec (CMMTQ) qu’il faut faire la demande.
Quel est le prix pour obtenir une licence RBQ ?
Il y a évidemment plusieurs coûts reliés à l'acquisition d’une licence RBQ. D’abord, pour l’évaluation de la demande, il faut payer chaque examen, demande d’équivalence de formations ou vérification de dossier professionnel. Par la suite, pour ce qui est de la licence en elle-même, les prix varient en fonction du type demandé. Consultez le site Web de la RBQ pour connaître les montants exacts se rapportant à votre situation et avoir plus de détails.
Pourquoi est-ce important de se procurer une licence RBQ ?
En tant qu’entrepreneur, promoteur ou propriétaire d’un bâtiment destiné à l’usage public, effectuer des travaux sans licence RBQ est considéré comme une infraction. Si vous n’en possédez pas ou si la vôtre ne s’applique pas à la bonne sous-catégorie, vous risquez d’obtenir une amende assez coûteuse.
Rappelez-vous que les particuliers peuvent vérifier la validité d'une licence RBQ en tout temps sur le site Web de la RBQ. Ainsi, pour maintenir un lien de confiance avec eux et pour assurer la qualité et la durabilité de votre travail, prenez la validité de votre licence au sérieux.
Faites connaître vos services en tant qu'écoentrepreneur qualifié et profitez pleinement d'une licence RBQ
Faîtes connaitre vos services dans le répertoire Écohabitation pour les professionnels de la construction ! En vous créant gratuitement une page de compagnie dans notre répertoire, vous pouvez rejoindre une clientèle ciblée et promouvoir vos services. Écohabitation offre aussi aux professionnels l'accréditation Écoentrepreneur pour les pratiques environnementales.
Trouvez plus de pages sur les professionnels de la construction ci-dessous et dans notre guide de la construction écologique.
Trouvez des professionnels et des produits ainsi que des projets de maisons écologiques exemplaires dans notre répertoire de l'habitation durable. |

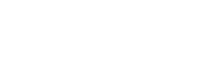















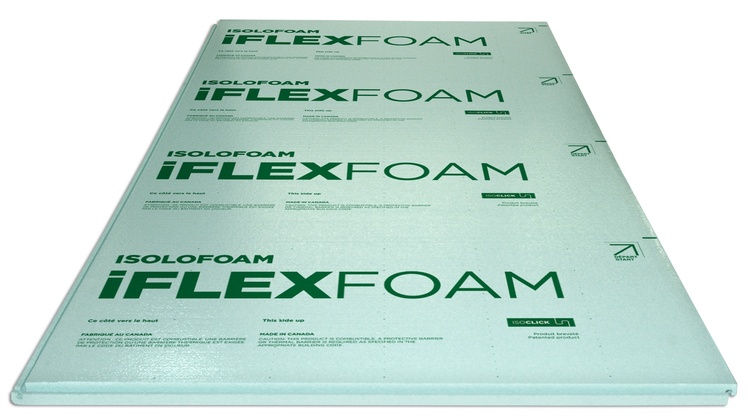



























Commentaires (0)
Inscrivez-vous pour commenter